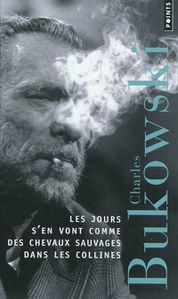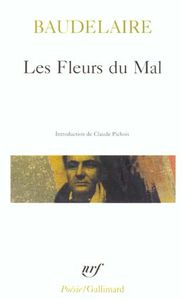Éditions Gallimard, 1981

Pour la grande majorité d’entre nous, le nom d’Herman Melville reste indissociable de son célèbre roman Moby Dick. Peu savent que l’écrivain américain consacra une grande partie de sa carrière d’écrivain à la poésie. Comme l’indique Pierre Leyris en introduction à sa préface : « longtemps, pour presque tous, la poésie de Melville resta sous-estimée en Amérique ». Ce recueil de dix-sept poèmes tirés de Battle-Pieces and Aspects of The War (Tableaux de bataille et aspects de la guerre) nous permet de découvrir une poésie très humaniste, proche de la nature, qui met en exergue le sacrifice des hommes lors de la Guerre de Sécession. Le point fort de ce livre est de nous proposer une édition bilingue de ces Poèmes de guerre, le lecteur pouvant effectuer un va-et-vient permanent entre la version anglaise et la version française. Petit bémol à ce sujet : je trouve la traduction française réalisée par Pierre Leyris de qualité assez inégale selon les poèmes. Mais il est vrai que l’exercice est tout sauf facile. La poésie d’Herman Melville est logiquement bien plus forte et expressive dans sa version originale. Parmi tous les poèmes de ce recueil, c’est incontestablement celui relatant la bataille de Fort Donelson (12-16 février 1862) qui s’avère le plus marquant ; le lecteur se retrouve transporté tantôt en ville auprès de la population avide des nouvelles du front, tantôt au cœur des combats épiques pour la prise du fort. Laissons Melville nous conter une sortie des assiégés confédérés :
“After some vague alarms,
Which left our lads unscared,
Out sallied the enemy at dim of dawn,
With cavalry and artillery, and went
In fury at our environment.
Under cover of shot and shell
Three columns of infantry rolled on,
Vomited out of Donelson–
Rolled down the slopes like rivers of hell,
Surged at our line, and swelled and poured
Like breaking surf. But unsubmerged
Our men stood up, except where roared
The enemy through one gap. We urged
Our all of manhood to the stress,
But still showed shaterness in our desperateness.” (Donelson, p. 58)
Présent à la fin du livre, un Supplément écrit par l’auteur détaille l’état d’esprit dans lequel celui-ci composa ses Battle-Pieces, et fournit une prospective politique pour les États-Unis après la guerre civile. Soulignons l’excellent avant-propos de Philippe Jaworski, qui présente de manière claire et synthétique le contexte historique de la Guerre de Sécession.
Par Matthieu Roger